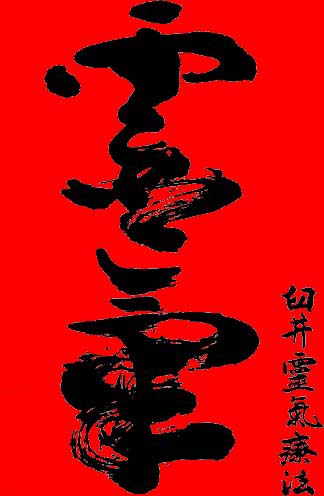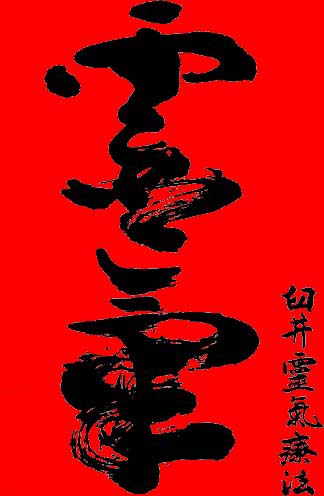
|
Chronique
Sciences-Techniques-Culture-Société
Les
sciences et les techniques ne sont pas seulement un savoir, encore moins
un savoir neutre. Elles sont le produit d’une société.
En tant que telles, elles ont besoin d’être situées
dans leurs dimensions éthiques, économiques, culturelles
et politiques.
C’est ce que tente André Giordan, professeur à l’université
de Genève et consultant auprès des organisations internationales,
les deuxièmes mardis du mois.
Le
non-penser technique
Il y a encore 200 ans, le nouveau citoyen qui avait vécu la Révolution
assistait au mieux à une seule innovation technique durant sa vie.
Le citoyen contemporain se trouve confronter presque mensuellement à
une nouveauté qui affecte durablement son existence. Ceux qui atteignent
ou dépassent la cinquantaine de nos jours ont dû intégré
depuis leur naissance le développement de l'électronique
domestique (transistor, télévision, magnétoscope,..),
de l'informatique (macro et micro), de la robotique, des télécommunications,
des banques de données, de l'énergie (nucléaire,
solaire,..), des nouveaux matériaux (multiples polymères
et intégrés pour la construction, les loisirs et même
pour les vêtements,..), des biotechnologies (médicaments,
diester,..), de l'imagerie médicale (échographie, scanner,
doppler, RMN,...). Nous ne serons pas exhaustif tant la liste est longue..
Notre intimité elle-même est affectée par ces bouleversements.
Tour à tour, les nouvelles techniques de sélection des espèces
(génie génétique,..), de culture (clonage, bouturage
in vitro, culture sans sol,..), de conservation (reconstitution, congélation,
lyophilisation,..) et de cuisson (induction, vapeur sèche, micro-ondes,..)
ont modifié les pratiques alimentaires. Les diverses pilules ont
changé la sexualité des femmes ; les techniques de procréation
assistée font évoluer le désir d’enfant...
Dans les seuls cinq ans à venir, ces mêmes individus devront
encore s’affronter au développement des machines à
communiquer, des multimédias, des autoroutes de l'information et
de bien d'autres choses encore...
Or pendant que ces diverses technologies continuent leur montée
en puissance, des doutes, un sentiment d'impuissance se répandent
dans la majorité de la population. Implicitement naissent une série
de questions. L'emballement des technologies asservie à l'économie
de marché n'est-elle pas en passe de faire dérailler l'humanité
? Est-il encore possible de maîtriser le développement technique
? Et surtout quel sens tout cela a-t-il ? Un sentiment populaire se répand
qu'on ne peut plus avancer sans savoir où l'on va.
La notion de progrès est contesté ; des problèmes
écologiques et de nouvelles épidémies surgissent
au grand jour, augmentant de l'inquiétude. Apparaissent des phénomènes
de rejet. L'intégrisme, le nationaliste exacerbé y puisent
même leurs éléments d'argumentation.
L'angoisse devant la possibilité d'un énorme dérapage
s'étale déjà à la une des journaux. A terme,
on peut craindre une crise profonde. Ses prémisses sont déjà
présent dans la crise de société que nous traversons.
Suivre le rythme des transformations ?
Tout cela n'a rien d'étonnant. Les technologies apparaissent comme
un non-penser de notre société. Du moins, la pensée
n'arrive plus à suivre le rythme des transformations techniques.
Les raisons de ce décalage sont multiples. Schématiquement,
on peut mettre en avant le mépris habituel des intellectuels pour
tout ce qui touche de près ou de loin aux professions ou à
la quotidienneté depuis que les philosophes, puis les scientifiques
se sont séparées inéluctablement des pratiques. Ce
mépris est particulièrement violent chez les intellectuels
parisiens, toujours engoncés par des habitudes de corporation dans
la seule études des textes de références. Pourtant
de nos jours, le philosophe, le scientifique, le journaliste, l'essayiste
qui veut ignorer la réalité technique se condamne à
parler dans le vide.
Il faut y voir également le peu d'intérêt des ingénieurs
et des entrepreneurs pour tout ce qui touche à la réflexion
sur les aspects d'usage, les retombées sociales des innovations,
au dépend d’un culte de l'efficacité et de la productivité
économique sur le court terme. Quant aux humanités, elles
restent toujours suspectes de verbiage, notamment dans les Grandes Ecoles.
Ajoutons encore le dépassement complet de nos politiques. Sur ces
questions, ils s'en remettent les yaux fermés aux experts. Cela
d'autant plus qu'aucun grand principe de régulation n'est inscrit
dans la Constitution. Les grands choix technologiques ne sont jamais véritablement
débattus aux Chambres. A-t-on déjà vu un jour un
grand débat sur l'énergie, les transports, les nouvelles
technologies de l'information ou même sur le type de recherches
à promouvoir ? Et nous ne parlerons pas ici de la reprise des essais
nucléaires...
Les évolutions technologiques sont alors menées uniquement
à l'initiative des compagnies multinationales, même si parfois
ces choix sont entérinés ultérieurement par les gouvernements.
Les compétences sont transférés de l'Etat aux initiatives
privées ; le tout apparaît très délocalisé
et multiforme. Les techniques et leurs normes s'imposent sans que jamais
le citoyen n’ait eu son mot à dire... Mieux, on a même
su créer chez ce dernier un complexe d'infériorité
pour qu’il s’en désintéresse.
Faire évoluer les mentalités
Une évolution des mentalités est absolument nécessaire.
Une éducation aux technologies peut être envisagée
de façon profitable dès l'école maternelle (1). Il
est regrettable que cet enseignement soit toujours balbutiant ou dévalorisé
pour le plus grand nombre. Nulle part il apparaît comme l’une
des priorités. Dans le même temps, des émissions de
télévision et des articles de journaux pourraient présenter
et situer les principales avancées. Passionnants comme toute aventure
humaine, ces reportages pourraient tout à la fois ouvrir l'individu
sur le monde qui l'entoure et lui fournir des éléments de
maîtrise (attitudes, démarches, réflexions sur,..).
En amont des études précises sont à mettre en oeuvre.
Il s’agit de rechercher les conditions culturelles de cet "enjeu
du siècle" (Ellul). Penser les techniques ne signifie pas
disserter sur chaque innovation ou production prise séparément.
Penser les techniques, c'est les situer dans leurs fonctions biosocioéconomiques,
c'est à dire dans la relation à la fois individu-machine
(quel plus m'apporte ce produit ou ce processus de fabrication ? par exemple).
C’est également repérer leurs implications dans un
groupe social (combien ça coûte ? quel changement induit-il
? quelle incidence sur l'emploi ?,...) et dans la biosphère (quelles
retombées à court et à long terme sur l'environnement
?). Penser les techniques, c'est envisager encore leur rôle historique
dans le développement d’une Nation, ou encore situer leur
évolution dans le contexte international (notamment en liaison
avec le déséquilibre grandissant entre le Nord et le Sud).
En fait, c'est un système de questions qu'il s’agit de traiter.
Elles touchent tout la fois à l'éthique, à la politique,
à l'éducation, à la culture, au droit, à la
consommation... En premier, il s’agit d’aborder de front la
question du rythme et de la nature des changements. Peut-on faire évoluer
des comportements quotidiens, des façons de penser au rythme des
transformations techniques? N’oublions pas qu’elles-mêmes
sont sous-tendues par des impératifs économiques. Faut-il
envisager des transitions ? Faut-il au contraire intervenir pour limiter
tel développement ? Autant de contradictions et de paradoxes à
gérer.
En tout cas, une nouvelle responsabilité collective est à
promouvoir. Etre citoyen aujourd'hui ce n'est plus seulement voter pour
son député ou son Président, puis s'en remettre à
lui (du moins à ses experts) et attendre. Etre citoyen, c'est se
positionner, entre autre, devant les intrusions de plus en plus pressantes
des techniques. Pour y parvenir, c'est interpeller les experts, c'est
repérer leurs compétences et la manière dont ils
ont été choisis. C'est surtout demander plus de transparence
dans les choix et en particulier exiger de débattre contradictoirement
des finalités.
N'oublions pas que le citoyen est également un consommateur et
qu'il a le droit de boycotter un produit ou une fabrication, tant qu'il
n'en possède pas tous les tenants et les aboutissants. Encore faut-il
que ses choix soient réfléchis et non le fruit d'une impulsion,
d'un conditionnement ou d'une mode.
(1) L’AGIEM
l’association des maîtresses d’école maternelle
s’en sont préoccupée, elle a pris l’idée
à bras le corps lors de leur dernier Colloque de juillet 1995.
Elle est encore peu suivie et soutenue par les décideurs. |